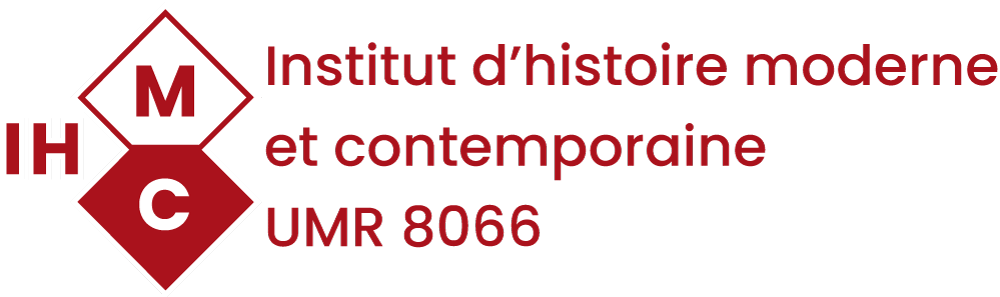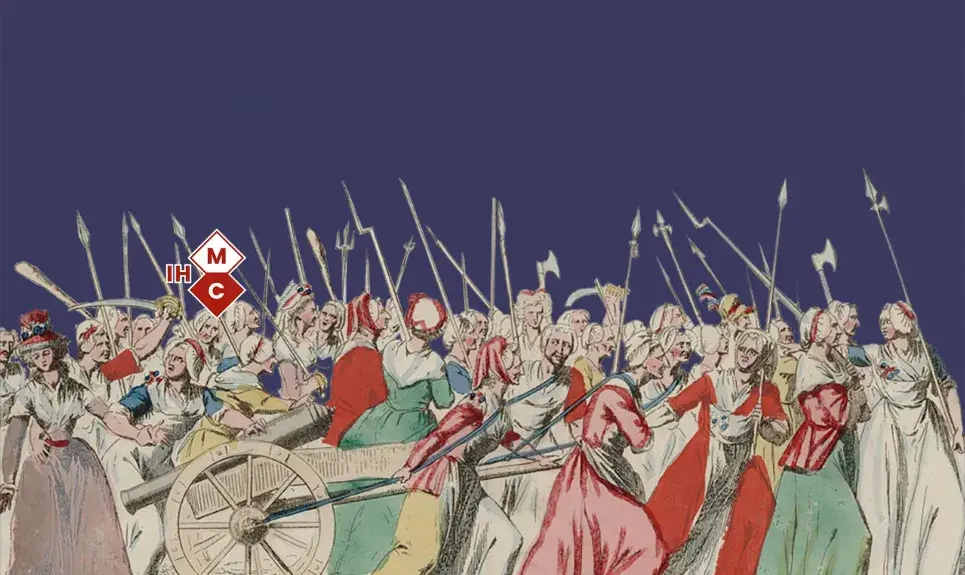
L’Institut d’Histoire de la Révolution française, fondé en 1937, a été intégré en 2016 à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), qui continue de gérer, en Sorbonne, de très riches fonds documentaires et assure l'animation des études révolutionnaires.
La Bibliothèque d’histoire de la Révolution française (BHRF) est une bibliothèque de référence consacrée aux Révolutions occidentales de la fin du xviiie siècle au début du xixe siècle. Elle comprend plus de 18 000 ouvrages, 12 000 titres des Archives de la Révolution et 1 300 thèses et mémoires, qui lui valent de bénéficier du label CollEx. Elle a été constituée par des acquisitions, des dons et des legs successifs.
Depuis 2009, est publiée dans le cadre de l’unité de recherche une revue en ligne, consultable sur le portail Openedition Journals, intitulée La Révolution.
-
Historique de l’IHRF (1937-2016)
Avant le centenaire de la Révolution française et dans un contexte d’affirmation de la République, la Mairie de Paris finança la fondation d’une chaire d’histoire de la Révolution à la Sorbonne dont le premier titulaire fut Alphonse Aulard (1849-1928). Il eut pour successeur Philippe Sagnac (1868-1954) et Albert Mathiez (1874-1932). Le 27 octobre 1937, à l’initiative de Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale du Front Populaire, fut fondé l’Institut d’histoire de la Révolution française dont le premier directeur fut Georges Lefebvre, qui venait d’être élu à la chaire d’histoire de la Révolution française dans le but de donner un nouvel élan aux études révolutionnaires dans la perspective du 150° anniversaire de la Révolution française. Le déclenchement de la guerre et l’Occupation conduisirent Georges Lefebvre à prendre sa retraite en 1941 tout en restant à son poste de directeur jusqu’en 1945 pour préserver les ressources de l’Institut.
Il eut pour successeur Marcel Dunan (1945-1956), puis Marcel Reinhard (1956-1967) qui développa les études démographiques sur les années 1789-1799. En 1968, Albert Soboul, qui fit sa thèse sur les sans-culottes parisiens sous la direction de Georges Lefebvre, accéda à la chaire d’histoire de la Révolution et à la direction de l’IHRF, qu’il constitua en pôle de résistance, dans les années 1970, contre l’école conservatrice conduite par François Furet. Tenant d’une histoire sociale des catégories et des appartenances politiques, il organisa, en autres, en 1975 un colloque sur Girondins et Montagnards. Michel Vovelle, directeur de 1982 à 1993, élargit le champ de recherche à l’histoire des mentalités et des images tout en animant les travaux autour du Bicentenaire de la Révolution. Les directeurs suivants contribuèrent à l’élargissement des thématiques de recherche : Catherine Duprat sur la philanthropie ; puis Jean-Clément Martin (2000-2008) sur la guerre de Vendée et sa mémoire, la Contre-Révolution et la violence en révolution ; enfin, Pierre Serna, sur le Directoire, l’histoire coloniale et l'histoire animale. Le 1er janvier 2016, l’IHRF fut intégré dans l’IHMC et n’a plus d’existence juridique. Demeure le riche héritage d’une institution qui s’est confondue avec les travaux et la personnalité de ses directeurs successifs et qui a apporté une contribution décisive aux études révolutionnaires.
Consulter le site de l'IHRF (archivé en 2021).
Actualités et informations
-
[Revue] La Révolution française – 27 | 2024
 Le numéro 27 | 2024 de La Révolution française, les Cahiers de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française est paru aujourd'hui sur OpenEdition Journals.
Le numéro 27 | 2024 de La Révolution française, les Cahiers de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française est paru aujourd'hui sur OpenEdition Journals.Dirigé par Frédéric Régent, il comporte un dossier sur « Vivre la Révolution de Saint-Domingue (1789-1804) ».
Le présent dossier traite de la révolution de Saint-Domingue sous un angle particulier : il s’attache à des individus considérés dans leur intégrité propre ou au sein de leur groupe d’appartenance, revendiqué ou assigné, et suivis durant une période faite de bouleversements majeurs qui transforment leurs vies. Ce sont donc les notions de destins historiques, de trajectoires personnelles ou collectives, dans un monde largement métissé, qui ont été mobilisées pour rendre toute son importance et sa complexité à un vécu historique irréductible aux oppositions binaires.